Avec l’IA, les seniors se retrouvent confrontés à une discrimination algorithmique. Le défi pour les entreprises : les intégrer dans la révolution numérique, et saisir les opportunités de la silver économie.
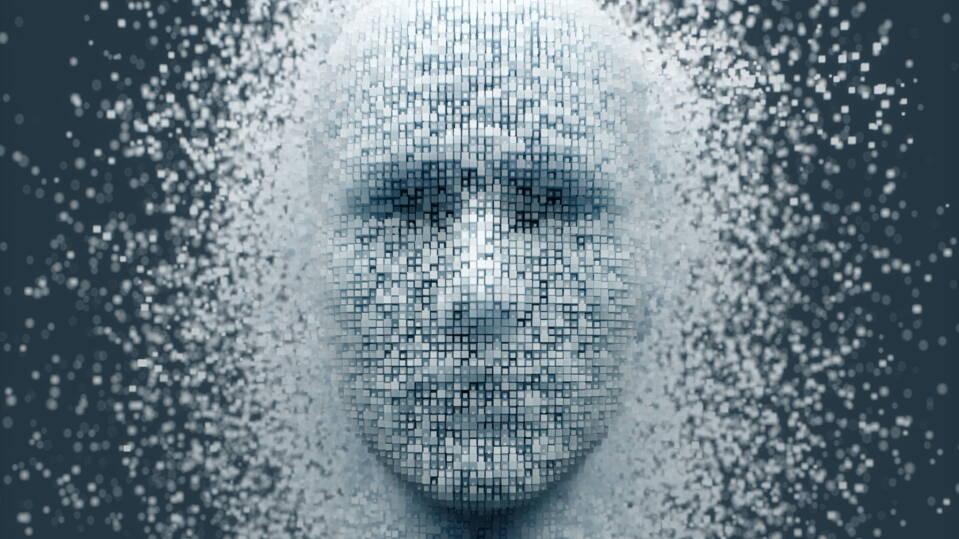
En 2024, nous interagissons quotidiennement, souvent sans le réaliser, avec des intelligences artificielles (IA) dont le modèle algorithmique pilote le fonctionnement. Ces modèles sont entraînés ou calibrés sur des jeux de données en capturant les signaux forts et faibles du phénomène modélisé, dans l’objectif de répondre à une question ou de résoudre un problème (« Quand la machine apprend : La révolution des neurones artificiels et de l’apprentissage profond », de Yann Le Cun, Odile Jacob, 2019).
Malgré les progrès considérables réalisés dans des domaines tels que la santé, l’éducation, les transports et la communication, nous assistons à l’émergence de cas de discriminations technologiques. Ces discriminations se manifestent par un traitement différencié, et souvent injuste, appliqué par les algorithmes intégrés aux technologies, en fonction du genre, de la couleur de peau, de la langue ou de la classe sociale des individus (« Algorithmes : la bombe à retardement », de Cathy O’Neil, Les Arènes, 2018 / « Contre-atlas de l’intelligence artificielle », de Kate Crawford, Zulma, 2022).Moins évoquées mais tout aussi importantes, les discriminations technologiques basées sur l’âge tendent à écarter et à sous-estimer injustement les seniors. Une forme d’invisibilisation ou de stigmatisation de cette population se dessine ainsi dans la conception et le fonctionnement des modèles d’IA, qui devraient pourtant être inclusifs sur tous les plans : économique, social et sociétal.
Les seniors et la silver economie : un enjeu pour les entreprises et la société
Selon la théorie du cycle de vie, dite de Modigliani, les individus expérimentent trois cycles principaux dans leur vie d’adulte qui se distinguent par le capital qu’ils détiennent en moyenne. Alors que le jeune a un capital négatif, il va ensuite l’augmenter en recouvrant ses dettes par son travail, pour ensuite entamer un troisième cycle incarné par le passage à la retraite où il consommera son capital précédemment accumulé (« The « Life Cycle » Hypothesis of Saving: Aggregate Implications and Tests », d’Albert Ando et Franco Modigliani, 1963).
Depuis les années 2000, cette théorie est reconsidérée au regard des nouveaux comportements des seniors, qui tendent à continuer à capitaliser dans l’objectif de garantir leur bien être et d’assurer un avenir plus incertain (« Les comportements financiers des seniors – Choix patrimoniaux et représentations sociales », d’Alain Tourdjman et Yann Benoist-Lucy, 2006 / « Les Français, l’épargne et la retraite », de Frédéric Dabi et Jean-Philippe Dubrulle, 2023).
Le terme de « silver économie » a émergé au début des années 2000 pour combler un vide dans l’analyse économique des nations industrielles. Cette approche vise notamment à prendre en compte l’influence croissante des seniors sur l’économie.
Loin de se limiter aux seuls services à la personne et à la prise en charge des personnes âgées, la silver économie englobe un large éventail de secteurs. Il est ainsi crucial de considérer les seniors non pas comme des bénéficiaires passifs, mais comme des acteurs actifs de la croissance économique. Leurs comportements financiers, notamment en matière de gestion de leur capital, en témoignent.